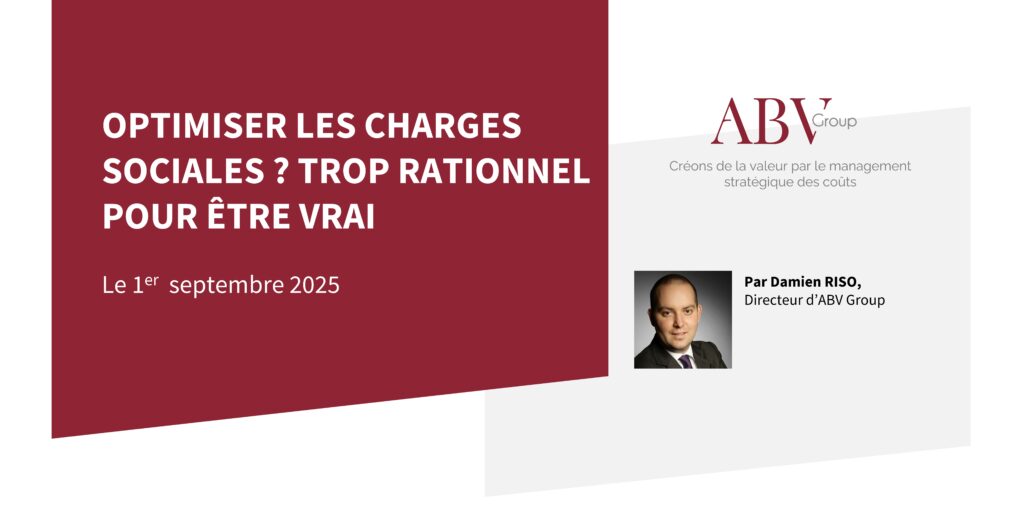
Tribune : OPTIMISER LES CHARGES SOCIALES ? Trop rationnel pour être vrai
Par Damien Riso – 01/09/2025
À première vue, la conjoncture appelle à l’action. Les textes s’empilent, les décrets passent sous les radars, les réinterprétations et jurisprudences affluent, la paie devient un territoire sous haute tension : chaque ligne du bulletin est traçable, chaque interprétation vérifiable, chaque déclaration potentiellement contestable. Tout semble indiquer qu’il faut agir. Et pourtant, les entreprises s’abstiennent. Comme si le trop-plein de normes paralysait toute initiative, comme si l’inflation réglementaire provoquait une forme de sidération.
Dans un monde économique où chaque euro compte, cette inertie a quelque chose de vertigineux. La masse salariale — premier ou deuxième poste de dépense des entreprises — concentre une part cruciale des enjeux de rentabilité. Et pourtant, l’un de ses volets les plus complexes, les charges sociales, demeure un angle mort en pilotage automatique.
Les Directions financières traquent partout les économies de fonctionnement, redéfinissent les chaînes de valeur, optimisent les achats, automatisent les processus… mais laissent intact le poste « charges sociales », pourtant un des plus opaques, techniques, instables, et, paradoxalement, optimisables.
Pourquoi ? Ce serait « déjà géré » par un SIRH, un cabinet ou un logiciel. En réalité, le déclaratif est géré, l’optimisation n’est pas pilotée. C’est un peu comme confier une chirurgie de précision à un robot sans vérifier ses capteurs.
Du côté des ressources humaines, même déni. Submergés par les urgences du moment – attractivité, rétention, climat social, IA, RSE, – les DRH arbitrent. Et lorsqu’ils doivent choisir entre un plan de formation, une négociation sociale ou un audit de charges sociales, la routine l’emporte : la paie doit rester silencieuse. Tant qu’elle ne fait pas de bruit, elle n’a pas d’existence. Et tant pis si, dans ce silence, dorment quelques dizaines ou centaines de milliers d’euros par an.
Car c’est bien là que réside l’absurde : ce que l’on croit être optimisé ne l’a souvent pas été. L’habitude a pris le pas sur l’analyse. Les équipes internes, expertes de la paie, sont souvent enfermées dans ce qu’elles ont elles-mêmes définies : des routines de paie inchangées, répétées, peu interrogées. Difficile d’être à la fois juge et partie. Il suffit de demander à un responsable de la paie s’il pense que ses pratiques méritent un audit. Il répondra presque toujours par la négative, avec assurance. Mais cette certitude repose moins sur la preuve d’un diagnostic avéré que sur une confiance acquise par habitude : des pratiques maîtrisées, certes, mais rarement challengées. Toutes les missions réalisées par des experts indépendants le montrent : il y a toujours à gagner. À condition, évidemment, de vouloir regarder.
Encore faut-il que les organisations soient en état d’ouvrir les yeux. Et c’est là que surgit un frein moins visible, mais tout aussi puissant : l’usure interne. Depuis la crise de la Covid, les entreprises vivent sous tension. Surcharge chronique, empilement des priorités, fatigue managériale, lassitude des équipes. Dans ce climat, chaque projet devient suspect. Même ceux qui sont utiles, simples ou rentables. Les RH, comme les managers, redoutent le fameux « projet de trop », celui qui épuisera les équipes ou désorganisera le quotidien. Alors on évite. On reporte. On hiérarchise non plus selon le gain, mais selon ce qui est imposé et selon ce que l’organisation est encore capable d’absorber.
Cette inertie illustre la règle du 12-6-3 : douze mois pour se décider, six mois pour contractualiser, et l’exigence d’économies en moins de trois mois. Un paradoxe temporel qui explique pourquoi tant de projets rentables sont différés ou abordés trop tardivement.
C’est précisément pour cela que certains projets doivent être pensés autrement. Externalisés. Légers. Discrets. Sans effet tunnel. Comme une respiration dans un système saturé. L’optimisation des charges sociales appartient à cette catégorie : elle ne prend rien, elle rend. Et plus tôt elle commence, plus fort elle rend.
Le plus troublant reste sans doute le raisonnement circulaire des objections. « On n’a pas le temps », dit-on. Mais ces audits sont conçus pour fonctionner hors flux, sans perturber les équipes. « On change d’outil », rétorque-t-on. Or justement : avec la migration, tout ou partie de l’historique disparaît, et toute analyse rétroactive devient limitée, parfois impossible. « On a peur de déclencher un contrôle », entend-on aussi. Pourtant, les optimisations proposées sont 100 % légales, documentées, souvent plus solides que les pratiques en place. « On a déjà fait un audit », concluent certains. Mais il s’agissait souvent d’un audit lointain, d’il y a 2-3 ans ou plus, partiel, déclaratif, généraliste, sans la finesse technique que ces sujets d’actualité exigent.
Et quand il ne reste plus d’argument, on invoque la priorité. Ce n’est pas celle du DRH, ni celle du DAF, ni celle du DG, “pas dans ma scorecard !”. Un sujet sans propriétaire, donc. Ce qui n’empêche pas qu’il profite à tous : à la marge nette, à la fiabilité des déclarations, à l’image de rigueur budgétaire. Voilà sans doute l’un des paradoxes les plus savoureux : un enjeu transversal, jugé trop périphérique pour être central, mais trop utile pour être ignoré.
Le comble, c’est que ce « non-sujet » est, malgré tout, un marché en pleine expansion : les cabinets spécialisés multiplient les missions, les webinars sur les charges sociales affichent complet, les retours sur investissement sont élevés. Tout augmente. Et pourtant, à chaque proposition, les mêmes réactions reviennent : « ce n’est pas notre priorité », « on le fait en interne », ou pire : « on verra plus tard ». L’absurde administratif atteint ici son sommet.
On accepte qu’un inspecteur URSSAF vienne tout examiner, sans forcément comprendre ce qu’il cherche. Mais on refuse qu’un expert mandaté, dont le seul but est de créer de la valeur, accède aux mêmes données. On préfère se battre en aval sur les redressements d’une lettre d’observations plutôt que de revendiquer en amont des exonérations oubliées — ou, plus absurde encore, de tenter de faire valoir des économies en réponse à cette même lettre d’observations. On reconnaît le besoin d’information en assistant à des conférences techniques, mais on décline l’expertise qui transformerait cette information en gains concrets. On dit manquer de temps, mais on refuse une mission qui en fait gagner.
En somme, les entreprises agissent comme si elles redoutaient l’examen minutieux que cette mission exige. Un examen opérationnel, technique, froid, mais fécond. Comme si elles préféraient l’approximation rassurante à l’optimisation démontrée. Comme si, au fond, dans le brouhaha quotidien, elles savaient qu’il y a de l’or sous leurs pieds… mais qu’elles refusaient de confier la pioche à ceux qui peuvent creuser.

À propos de l’auteur
Depuis plus de 20 ans, Damien RISO accompagne les entreprises dans l’optimisation et la sécurisation de leurs charges sociales. Directeur d’ABV Group, chroniqueur des Actualités Brûlantes des DRH dans la revue RH&M et animateur des Baromètres des DRH et des DAF, il intervient précisément là où les pratiques internes atteignent leurs limites et où un regard expert, indépendant et objectif permet de révéler de nouvelles marges de manœuvre. Vous vous reconnaissez dans cette tribune ? Contactez-le directement : d.riso.ext@abv-group.com
Contactez-nous
Nous vous proposons un entretien personnalisé et anonyme pour estimer vos économies potentielles.
Contactez-nous :

